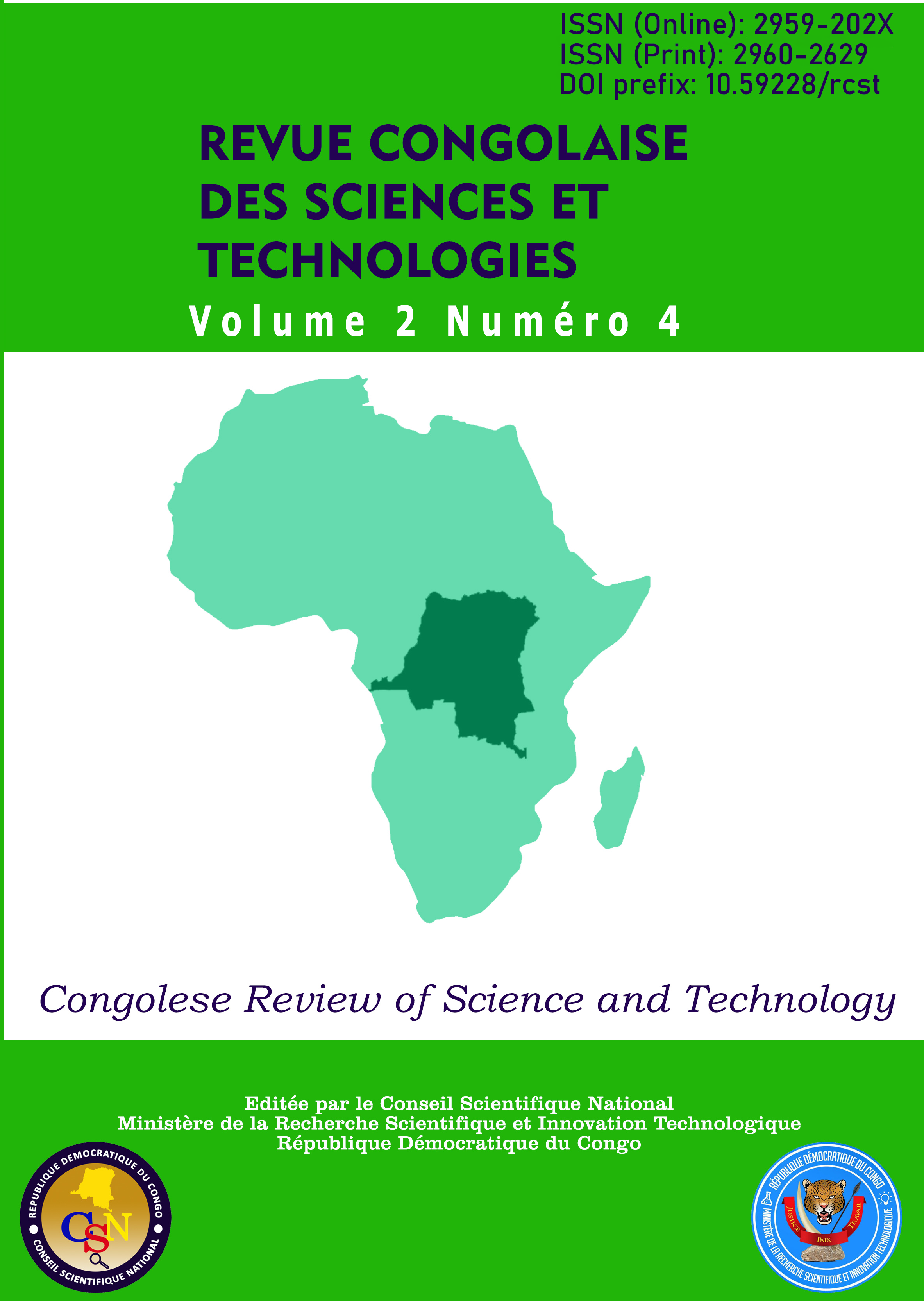Impacts du phénomène socio-culturel « ambo-ambo » sur le développement durable de la ville d’Inongo : Analyse de la crise et pistes de solution
Contenu principal de l'article
Résumé
Dans la ville d‘Inongo, Province du Maï-Ndombe en République Démocratique du Congo, le phénomène socioculturel « ambo-ambo » est en
vogue. A voir son déploiement actuel dans l‘environnement socio-culturel, il risque de porter préjudice à la vision, à la culture et à la
pratique du développement durable de ce milieu. D‘où, une enquête socio-environnementale de terrain constituée d‘un échantillonnage
représentatif de 1558 sujets a été organisée dans la Commune de Pongonzoli afin de comprendre et d‘expliquer l‘essence, les causes et
conséquences du phénomène. Appuyée par l‘observation directe et qualitative, la revue documentaire, les interviews et entretiens et
l‘approche systémique pour la collecte, le traitement et l‘analyse des données, l‘étude a pu obtenir les grands résultats suivants: 87,5 % des
sujets reconnaissent l‘existence du phénomène « ambo-ambo » compris comme « une diplomatie de mensonges » (44 % des sujets enquêtés)
subtilisée par les usagers pour « la courtisanerie » (55 % des sujets enquêtés). Les groupes ethniques géniteurs du phénomène sont
essentiellement les Bolia (53,6 % des sujets enquêtés) et les Ntomba (44,4 % des sujets enquêtés). Sa diffusion se fait par « emprunts » (52,2
% des sujets enquêtés) des noyaux culturels originaires. Sa pratique répond aux « impératifs de survie » (40 % des sujets enquêtés) pour
résilier à la pauvreté. Ses conséquences sur le plan social, psychologique, culturel et éthique sont entre autres: conflits (43 % des sujets
enquêtés) ; crise de personnalité (53 % des sujets enquêtés) ; hypocrisie intellectuelle (46 % des sujets enquêtés), irresponsabilité et culte de
médiocrité (47 % des sujets enquêté). Pour pallier au phénomène et afin de construire ensemble une culture du développement durable,
l‘étude propose ceci : la réduction de l‘extrême pauvreté, l‘amélioration de la gouvernance socio-environnementale, la bonne gestion de la
liberté publique pour tous, lutte contre l‘irresponsabilité par des sanctions légales et des antivaleurs.
Details de l'article

Ce travail est disponible sous licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.
Références
Derrida, J. (1972). Marges de la philosophie. Paris,
Minuit.
Jonas, H. (1991). Le principe responsabilité. Ethique
pour une civilisation technologique. Paris,
Cerf.
Mala, A. (2021). Le retour de Zarathoustra. Paris,
L'Harmattan.
Morin, E. (2016, février). Le temps est venu de
changer de civilisation. La Tribune.
Mbaya, R. (1998). Aspects économiques et sociaux
de la rémunération du travail au Zaïre. Cas de
salariés de Kisangani. Afrique et
Développement, pp. 159 - 184.
Ordioni, N. (2011). Le concept de crise: un
paradigme explicatif obsolète? Une approche
sexospécifique. Mondes en Développement,
(154), 137 – 150.
Saka, F. (2023). Les paradoxes de la responsabilité
écologiques. Essai pour éthique durable du
développement durable [Thèse de Doctorat,
Département, UNISA].